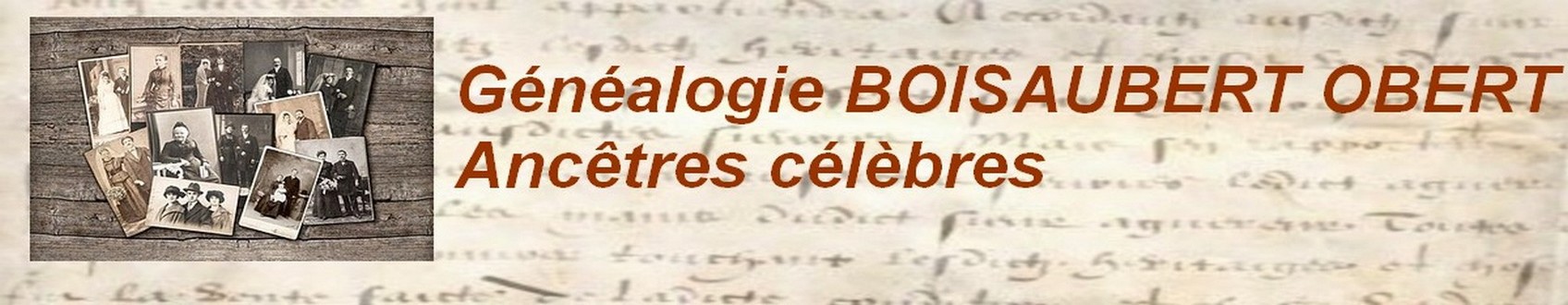Dans l'arbre de la famille OBERT, figure la famille PERRIER. L'ancètre Marc PERRIER dit l'Ancien, vigneron donnera naissance à des filles et garçons dont plusieurs travailleront à la Manufacture de la Toile de Jouy.
Les Ouvriers de la Manufacture
Au cours de la période 1760 - 1820, sur les 833 ouvriers, 69,2% signent. Sur les 600 ouvriers masculins 76% signent et sur les 233 ouvrières 51,5% signent. Il s’agissait d’un bon niveau d’alphabétisation pour l’époque.
A Jouy, 28% des apprentis débutants savent signer, ils sont 80% à la fin de leur apprentissage.
Les horaires de travail sont en été de 6h à 19h et en hiver de 7h à 17h, avec un arrêt d’une heure pour déjeuner.
En 1780, les dessinateurs et les graveurs reçoivent à Jouy un salaire moyen trois fois supérieur à celui des imprimeurs qui gagnent eux mêmes le double des journaliers. Les coloristes sont les mieux payés, l’art de faire les couleurs offre parfois des salaires fabuleux.
Vers 1800 les enfants de 8 à 16 ans représentent 11% de l’effectif masculin de la manufacture.
En 1804 44% des ouvriers sont âgés de 25 à 45 ans, 30% de 16 à 25 ans et 11% ont moins de 16 ans.
En 1805 Jouy compte une vingtaine d’emplois différents. Des dessinateurs aux imprimeurs, des coloristes aux renteurs, des pinceauteuses aux apprêteurs et les emballeurs.
Il y a 3 dessinateurs, 45 graveurs, 30 picoteuses, 6 coloristes, 185 imprimeurs ou imprimeuses, 570 pinceauteurs ou pinceauteuses, 52 batteurs, blanchisseurs. 360 sont des ouvriers qualifiés, 958 sont non qualifiés.
En 1815 Jouy compte 400 ouvriers alors qu’en 1790 elle en comptait 900 et en 1806 plus de 1000.
En mai 1818 J. M. Perrier contracte un engagement décennal (contrat de travail) pour tous travaux relatifs au dessin sur pied de 3 000 francs par an, l’équivalent de sept fois le salaire moyen d’alors.
Deux mois après F. M. Perrier dit le Jeune, graveur fidèle à la Manufacture gagne environ 1 400 francs par an.
La Direction met en place un système d’épargne forcée, par prélèvement annuel ou trimestriel obligatoire. Cette épargne est restituée au départ de l’ouvrier de l’entreprise. La retenue de J. M. Perrier en 1818 est fixée à 4 000 francs, soit 133% de son salaire annuel, prélevée en retenant 1 800 francs par an.